Pour un pragmatisme responsable
Compléments à la fresque de l'agilité
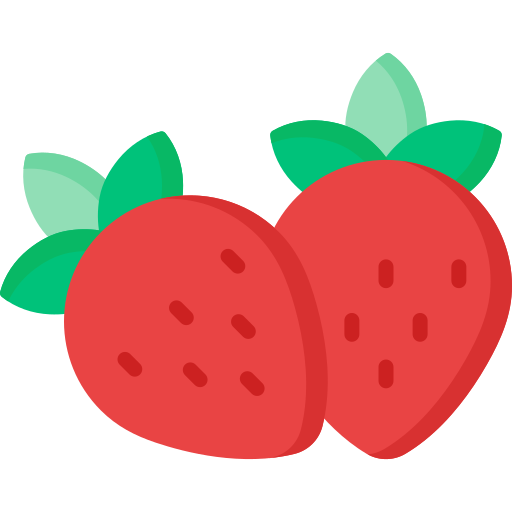
Cet article est inspiré par les conversations sur les fondamentaux et principes de l’organisation du travail que nous questionnons dans l’exercice de la fresque de l’agilité.
La question ici est de savoir si le pragmatisme est à la bonne place pour discuter de l’organisation des personnes en permettant de dépasser dans le management traditionnel ou moderne, les principes et les limites de la division du travail.
Nous entendons par management moderne, celui qui a pu incorporer une forme d’agilité avec les mêmes intentions que celles du management traditionnel.
Le pragmatisme comme valeur centrale de l’agilité
Un des piliers ou fondamentaux de l’agilité est le pragmatisme : l’amélioration continue par l’expérience, le test et l’apprentissage. Plutôt que de débattre indéfiniment sur le bienfait théorique d’une idée ou d’une innovation, l’agilité nous invite à :
- Adopter un point de vue pratique et expérimental
- Tester rapidement (MVP, spike, expérimentation)
- Porter un regard aussi objectif que possible sur les résultats
- Apprendre collectivement et partager les découvertes
Itérer les expériences en n’oubliant pas de s’arrêter un instant pour apprendre, a minima identifier ce que nous venons d’apprendre et ce qu’il nous resterait à apprendre, pour repartir dans une nouvelle boucle d’apprentissage digne du PDCA.
Les boucles d’apprentissage peuvent avoir une portée différente selon les niveaux de maturité et d’influence de l’équipe. Aussi pragmatisme mérite d’être nuancé.
Trois concepts fondamentaux à clarifier
1. Empirisme — Fondation de la connaissance
L’empirisme repose sur l’idée que la connaissance provient de l’expérience directe et de l’observation. En agilité :
- On abandonne les certitudes abstraites au profit de l’expérimentation concrète
- On valorise les données et retours terrain plutôt que les prévisions théoriques
- On reconnaît que chaque contexte est unique et doit être exploré
Scrum est d’ailleurs porteur d’une valeur d’empirisme dans son guide de référence.
2. Utilitarisme — Maximiser le bien-être du plus grand nombre
Dès lors que l’on s’intéresse à la valeur d’usage pour les utilisateurs, il est tentant de faire le pont entre l’utilité et l’utilitarisme.
L’utilitarisme classique c’est : “agir pour le plus grand bien du plus grand nombre”. Mais pour qui ? Et quel bien ? En agilité traditionnelle (celle du manifeste de 2001), le “bien” était d’abord défini
- comme faire le bon produit pour satisfaire le client
- comme le produit “bien fait” avec le souci de la qualité intrinsèque de l’excellence technique
- avec le souci de simplification pour minimiser le coût du changement. Cette simplification pour le bien-être aussi des développeurs s’est traduite par de l’optimisation de tâches de production et l’automatisation de tâches de répétitives (les tests notamment). Le travail ainsi “bien fait”, si on laisse le temps à l’équipe d’apprendre (empirisme) dans ce sens, continue de servir l’efficacité et la productivité demandée par les sponsors/managers, mais, les externalités (sociétales, environnementales) restaient invisibles
Limite critique : l’utilitarisme appliqué naïvement peut masquer des impacts négatifs qui ne sont pas comptabilisés (pollutions, inégalités, dépossession de savoir-faire / capacités à décider / données).
3. Pragmatisme — Adapter les moyens aux fins
Le pragmatisme dépasse empirisme et utilitarisme en posant : “Qu’est-ce qui marche, dans ce contexte, pour qui, et à quel coût réel ?”
- C’est une philosophie de l’action ancrée dans les conséquences
- Elle reconnaît que “marcher / fonctionner” n’est pas une mesure unique ou neutre, ni suffisante
- Elle appelle à revoir continuellement nos intentions et impacts
Agilité radicale — Élargir la notion de “bien”
Beaucoup d’agiliste limitent le “bien” fondé de leur action à la valeur business, et plus précisément à la valeur financière.
L’agilité radicale propose de dépasser l’agilité centrée sur l’efficacité du client et l’optimisation des processus de production pour toujours plus de profits financiers. Elle ajoute :
Dimension sociale ou sociétale
-
Au-delà de “satisfaire le client” → Qui se développe ? Qui peut être exclu ?
-
Au-delà d’optimiser ressources → Quel impact sur les parties prenantes invisibles ? (travailleurs précaires, communautés affectées, générations futures)
-
Reconnaître que chaque décision crée potentiellement des gagnants et des perdants, une part de bien et une part de mal.
Dimension environnementale
- Au-delà de réduire coûts → Réduire empreinte carbone, consommation matière, toxicité
- Au-delà de digitaliser → Questionner l’utilité réelle : replace-t-on un processus nécessaire ou invente-t-on de la consommation de ressources numériques ?
- Accepter que certains “progrès” agiles (scaling illimité, croissance infinie) deviennent intenables
Dimension éthique
- Au-delà de mesurer satisfaction client → Pratiquer la responsabilité : quels risques créons-nous ? À qui d’en rendre compte ?
- Inverser le pragmatisme naïf : ce n’est pas “ça marche donc on le fait”, c’est “ça marche pour qui, et à quel coût pour les autres ?”
Évolution nécessaire des conversations
Pour progresser vers une agilité plus radicale, les dialogues doivent évoluer :
Avant (agilité classique)
- “Avons-nous satisfait le client ? Réduction de coûts ?”
- “Les processus sont optimisés ? La productivité augmente ?”
- Prémisse : plus c’est rapide et rentable, mieux c’est
Après (agilité radicale)
-
“Avons-nous créé de la valeur pour qui ? À quel coût pour les autres ?”
-
“Notre croissance est-elle soutenable (écologiquement, socialement) ?”
-
“Quels risques et dommages collatéraux n’avons-nous pas vus ?”
-
“Quels modèles alternatifs n’avons-nous pas explorés ?”
-
Prémisse : plus c’est pertinent et juste, mieux c’est — même si moins rapide ou moins rentable
Pragmatisme enrichi : l’approche proposée
Il s’agit d’adopter une approche pragmatique à partir des expériences réelles des participants, mais en élargissant ce qu’on observe et mesure :
-
Expérimenter non seulement ce qui fonctionne pour le client, mais aussi :
- Les impacts sur les équipes (burnout ? sens ? équité ?)
- Les impacts environnementaux (empreinte carbone, ressources, déchets)
- Les impacts sociétaux (exclusion, dépendance, inégalité)
-
Dialoguer en reconnaissant que “marcher” pour certains peut faire du mal à d’autres :
- Créer des espaces de voix pour les invisibles (stakeholders absents, générations futures, nature)
- Questionner collectivement nos intentions et intentions collaterales
-
Améliorer en tirant des leçons qui ne se limitent pas au ROI ou à la vélocité :
- Documentez les apprentissages éthiques et environnementaux
- Partagez ce qui marche et ce qui coûte, à qui, et pourquoi
Lien avec le manifeste agile original
L’intention première exprimée dans le Manifeste Agile était de partager ce que certains avaient appris en inventant d’autres façons de produire, pour aider les autres à “mieux faire”. Mais “mieux” doit évoluer : ce n’était pas juste “mieux pour le client et les bénéfices”, c’était aussi “mieux pour les gens, plus juste, plus responsable”.
L’agilité radicale redécouvre cette intention originelle, en l’enrichissant d’une conscience accrue des limites planétaires et des inégalités systémiques.
En conclusion
Le pragmatisme enrichi invite à :
- Garder l’empirisme (tester, apprendre, adapter)
- Élargir l’utilitarisme (au-delà du client, inclure les parties prenantes / stakeholders larges et sur tout le cycle de vie du produit)
- Accepter que certaines décisions “pragmatiques” doivent être reconsidérées à fréquence régulière et à la lumière d’impacts non visibles précédemment
- Dialoguer honnêtement et décider de façon transparente des compromis / trade-offs / paris qui font sens dans une économie symbiotique.
Cela demande une maturité dialogique nouvelle : reconnaître que nous ne voyons pas tout, que nos indicateurs de succès sont parcellaires, et que “faire avancer les choses” n’est pertinent que si nous clarifions : pour qui, à quel coût, et pour combien de temps encore ?
Ce pragmatisme ne peut être effectif que si supporté par les autres fondamentaux de l’agilité, que nous vous invitons à découvrir en participant à un atelier de cartographie / fresque de l’organisation du travail ou en consultant les articles ici, là Claude Aubry ou encore ici Agile radical

